JODDLE
Le Jeu des Objectifs de Développement Durable Engageant et Ludique
Le Jeu des Objectifs de Développement Durable Engageant et Ludique
JODDLE c’est l’acronyme de « Jeu des Objectifs de Développement Durable Engageant et Ludique », rien à voir avec le JODEL, ou Yodel, une technique de chant consistant à passer rapidement de la voix de corps à la voix de tête, typique de la Suisse centrale.
Pendant les trois prochaines semaines, nous allons chaque jour publier et dévoiler ici une des 17 petites histoires en relation avec les ODD, en passant par les cinq continents.
Le jeu est simple:
Le concours s’est terminé fin décembre 2024.
Retrouve les histoires et leur relation avec les ODD dans ce document PDF
Introduction et instructions
Les ODD – Objectifs de Développement Durable de l’ONU constituent une feuille de route pour transformer notre monde. Ces 17 objectifs abordent des enjeux majeurs tels que la pauvreté, le climat, l’égalité et bien plus encore. Cependant, ils sont souvent perçus comme des engagements réservés aux gouvernements et aux grandes institutions, ce qui peut te faire penser : « Ce n’est pas pour moi… ».
Pourtant, c’est faux. Chacun de nous peut contribuer aux ODD. Chaque geste compte, qu’il s’agisse d’une action locale ou d’un projet plus ambitieux. Une goutte d’eau, multipliée par des milliers, devient un torrent capable de changer les choses.
Nous avons choisi de raconter des histoires, car elles parlent à notre cœur, à notre imagination et à notre créativité. Elles montrent que des personnes ordinaires, comme toi, peuvent accomplir des choses extraordinaires. Ces récits dépassent le cadre rationnel pour toucher les émotions et démontrent que tout le monde peut commencer petit et faire de grandes choses.
Tu trouveras dans les pages de l’annexe, les définitions des 17 ODD – Objectifs de Développement durable.
Avec ce jeu, plonge dans ces histoires et découvre les causes qui t’inspirent le plus. Tu verras que les ODD ne sont pas seulement de grands idéaux inaccessibles, mais des opportunités concrètes pour faire avancer le monde… à ton échelle.
Bonne lecture, laisse-toi porter par ces étincelles d’engagement pour un monde plus juste et plus sûr.
Tableau de tes affinités des avec les ODD
Pour chaque histoire, fais la somme des points que tu as attribué à chacune des cinq questions. Reporte cette somme dans la colonne des points.
Tu verras ainsi les objectifs de développement durable pour lesquels tu as le plus de points, c’est-à-dire probablement la plus grande affinité.
| Histoire | Points | Objectif de développement durable |
|---|---|---|
| Une chance pour Jamila | 1. Pas de pauvreté | |
| Une récolte pour Rajesh et son équipe | 2. Faim « zéro » | |
| Le combat de Daniel pour sa communauté | 3. Bonne santé et bien-être | |
| Un cahier pour Yara | 4. Éducation de qualité | |
| Amina brise les chaînes | 5. Égalité entre les sexes | |
| L’eau, une promesse pour Fatou et ses voisins | 6. Eau propre et assainissement | |
| La lumière de Mikhail | 7. Énergie propre et d’un coût abordable | |
| Le pari de Lisa et sa boutique mobile | 8. Travail décent et croissance économique | |
| Jonah et le pont des possibles | 9. Industrie, innovation et infrastructure | |
| Le parcours de Mateo et Leïla | 10. Inégalités réduites | |
| Le quartier de Rosa renaît | 11. Villes et communautés durables | |
| Les éco-créateurs de Lausanne | 12. Consommation et production responsables | |
| Tane, gardien des mangroves | 13. Lutte contre les changements climatiques | |
| Le filet de Minh contre les plastiques | 14. Vie aquatique | |
| Kofi, les racines d’un avenir durable | 15. Vie terrestre | |
| Aisha, la bâtisseuse de ponts | 16. Paix, justice et institutions efficaces | |
| L’alliance de Mila et le mouvement des 100’000 | 17. Partenariats pour la réalisation des objectifs |
Retrouve les 17 histoires et leur relation avec les ODD dans ce document PDF.
A suivre, avec les cibles des ODD !
Claude Michaud
Une chance pour Jamila

Histoire de Jamila
Jamila regardait le soleil se coucher sur son petit village, une boule d’inquiétude dans la gorge. Elle savait que, demain, elle aurait encore à se demander comment nourrir ses deux enfants. Depuis la dernière sécheresse, la terre n’avait plus rien donné. Tout semblait s’effondrer autour d’elle, mais ce qu’elle craignait le plus, c’était le regard de son fils aîné, plein de questions qu’elle ne pouvait pas répondre.
Un jour, une rumeur courut dans le village. Des gens venus de la ville parlaient d’un programme pour aider les familles en difficulté. Jamila hésita. Etait-ce un autre mirage ? Mais la promesse d’un microcrédit lui donna un espoir timide. Avec cet argent, elle pourrait acheter quelques poules et essayer de démarrer un petit commerce d’œufs.
Les premières semaines furent dures. Les poules avaient besoin de soins constants, et Jamila ne dormait presque plus, mais elle voyait enfin une lumière au bout du tunnel. Elle vendit ses premiers œufs au marché du village. Le sourire de la cliente qui lui tendit l’argent lui resta gravé dans le cœur. C’était un début.
Avec ses revenus, elle put acheter des fournitures pour l’école de ses enfants. Pour la première fois, elle sentit qu’elle avait le contrôle, que son avenir n’était plus dicté par la fatalité. D’autres femmes du village la regardaient avec admiration. Ensemble, elles décidèrent de se regrouper en coopérative, partageant les coûts et s’entraidant pour maximiser leurs efforts. Les résultats dépassèrent toutes leurs espérances : des revenus plus stables pour les familles, des enfants à l’école et même des projets d’expansion.
Aujourd’hui, Jamila est devenue un modèle dans son village. Son courage et sa détermination ont non seulement transformé sa vie, mais aussi inspiré tout un réseau de femmes à croire en leurs capacités. Jamila se plaît à rêver. Un jour, peut-être, leurs produits voyageront bien au-delà du marché local.
Jamila nous montre que derrière chaque visage marqué par la pauvreté se cache une force incroyable, prête à s’épanouir avec un peu d’aide. Chaque petite action compte : soutenir des initiatives comme celle de Jamila peut briser le cycle de la pauvreté et offrir des opportunités à ceux qui en ont le plus besoin.
Rappel: attribue entre 0 et 5 points pour chaque question, calcule la somme et note sur une feuille tes points pour Jamila
Une récolte pour Rajesh et son équipe

Histoire de Rajesh
Dans une vallée reculée d’Asie du Sud, Rajesh, un agriculteur de 55 ans, marche lentement à travers ses champs asséchés. La terre autrefois fertile est craquelée par des années de sécheresse, et les rendements ont chuté de moitié. Rajesh ne se bat pas seulement pour nourrir sa famille, mais aussi pour fournir des légumes à son village. Les enfants souffrent de malnutrition, et les prix des denrées augmentent chaque mois. Dans ce contexte, l’agriculture semble devenue une bataille perdue.
Rajesh, pourtant, n’est pas seul. Avec cinq autres agriculteurs de son village, il décide de chercher des solutions. Ensemble, ils entendent parler d’un programme d’aide destiné aux agriculteurs en difficulté, qui introduit des techniques agricoles durables et des cultures résilientes face au climat. Encouragés, ils contactent l’organisme responsable et reçoivent des formations, des semences adaptées et des outils pour construire un système d’irrigation.
Les premiers mois demandent un travail intense. Ils installent des canaux d’irrigation et plantent des cultures résistantes à la sécheresse comme le millet et les légumineuses. Lorsque les premières pousses vertes émergent, Rajesh et son équipe sentent un regain d’espoir. Cette fois, les récoltes ne déçoivent pas. Les légumes et céréales remplissent à nouveau les paniers au marché local.
Ensemble, les agriculteurs ont non seulement renforcé la sécurité alimentaire de leur village, mais aussi réduit leur dépendance aux importations coûteuses. Les enfants retrouvent des repas nutritifs, et Rajesh peut enfin sourire en regardant ses champs. L’équipe ne compte pas s’arrêter là : ils ont commencé à partager leurs connaissances avec d’autres villages voisins.
Rajesh et ses compagnons montrent que même face à des défis colossaux, des communautés unies et des techniques adaptées peuvent faire reculer la faim. Il ne suffit parfois que d’un peu de soutien et de collaboration pour nourrir des vies et des rêves.
Rappel: attribue entre 0 et 5 points pour chaque question, calcule la somme et note sur une feuille tes points pour Rajesh
Le combat de Daniel pour sa communauté

Histoire de Daniel
Daniel, 28 ans, vit dans une région rurale d’Afrique de l’Ouest où l’accès aux soins médicaux est un luxe rare. Depuis l’enfance, il a vu des proches souffrir ou mourir faute de traitement. Un souvenir le hante particulièrement : celui de sa petite sœur décédée d’une maladie qui aurait pu être évitée avec un simple vaccin. C’est ce drame qui l’a poussé à étudier la médecine, malgré des défis immenses. Aujourd’hui, Daniel est de retour dans son village avec un objectif : changer les choses.
Avec l’aide d’une petite ONG locale, Daniel transforme un bâtiment abandonné en une clinique rudimentaire. L’organisation fournit quelques équipements de base, des médicaments essentiels et une formation supplémentaire pour lui permettre de gérer les cas les plus courants. Mais Daniel sait qu’il faut aller plus loin pour sensibiliser et prévenir.
Il mobilise les habitants pour organiser des campagnes de vaccination et des sessions d’éducation à la santé. Les mères apprennent l’importance de l’hygiène et des soins prénatals, tandis que les jeunes sont sensibilisés aux dangers des maladies infectieuses. Daniel se rend également dans les villages voisins avec une trousse médicale mobile pour toucher les plus isolés.
Au fil des mois, les résultats deviennent visibles. Les taux de vaccination grimpent, et les consultations augmentent dans sa clinique. Des maladies qui étaient autrefois fréquentes diminuent drastiquement. Plus important encore, les habitants commencent à prendre en main leur santé. Daniel forme deux jeunes du village pour l’assister et espère qu’un jour, ils deviendront eux aussi des acteurs clés de la santé communautaire.
Le travail de Daniel montre que des efforts locaux combinés à un soutien ciblé peuvent transformer la vie de milliers de personnes. Offrir à chacun l’accès à des soins de santé de base, c’est bien plus que soigner une maladie : c’est donner une chance à un avenir meilleur.
Rappel: attribue entre 0 et 5 points pour chaque question, calcule la somme et note sur une feuille tes points pour Daniel
Un cahier pour Yara

Histoire de Yara
Dans un petit village perché dans les montagnes d’Amérique latine, Yara, 10 ans, rêvait de devenir enseignante. Tous les matins, elle parcourait plusieurs kilomètres à pied pour rejoindre son école, une simple cabane en bois avec quelques bancs et un tableau usé. Le maître faisait de son mieux avec les moyens du bord, mais les livres manquaient, les cahiers étaient rares, et parfois, il fallait partager un stylo entre plusieurs élèves. Cela n’empêchait pas Yara de croire en ses rêves.
Un jour, la pluie s’abattit sur le village, détruisant la petite école. Les enfants n’avaient plus d’endroit pour apprendre, et beaucoup de familles, déjà précaires, n’avaient pas les moyens de reconstruire quoi que ce soit. Yara regardait son cahier abîmé par l’eau et sentait ses rêves s’éloigner. « Comment pourrais-je un jour enseigner, si je ne peux même plus étudier ? », se demanda-t-elle.
Mais l’histoire de Yara changea lorsque des bénévoles d’un projet d’éducation durable arrivèrent dans son village. Leur objectif : reconstruire des écoles et fournir des ressources pour une éducation de qualité, même dans les régions les plus isolées. Ils apportèrent non seulement des matériaux pour construire une école solide, mais aussi des livres, des cahiers et des outils numériques adaptés au contexte rural. Plus encore, ils formèrent les enseignants locaux pour renforcer leurs méthodes pédagogiques.
Yara retrouva sa classe, mais cette fois dans un bâtiment neuf et accueillant. Chaque élève avait son propre cahier et son propre stylo. Les nouveaux livres, remplis d’histoires captivantes, devinrent pour Yara une fenêtre ouverte sur le monde. Elle dévora chaque page avec enthousiasme, rêvant encore plus fort de son avenir.
Aujourd’hui, Yara est à l’université. Elle revient régulièrement dans son village pour aider les enfants à apprendre à lire et à écrire. Elle est devenue une source d’inspiration, non seulement pour les jeunes, mais aussi pour toute sa communauté, qui comprend désormais l’importance de l’éducation pour briser le cycle de la pauvreté.
L’histoire de Yara rappelle que l’éducation n’est pas un luxe, mais un droit. Partout dans le monde, des millions d’enfants comme elle attendent une chance d’apprendre et de bâtir un avenir meilleur. Avec les bonnes ressources et un soutien adapté, ces rêves peuvent devenir réalité.
Rappel: attribue entre 0 et 5 points pour chaque question, calcule la somme et note sur une feuille tes points pour Yara
Amina brise les chaines

Histoire d’Amina
Dans un quartier pauvre de la périphérie d’une grande ville en Asie centrale, Amina, 19 ans, rêve d’une vie différente. Depuis l’enfance, on lui a dit que son rôle était de se marier jeune, d’avoir des enfants et de rester à la maison. Pourtant, Amina a soif d’apprendre et d’indépendance. Chaque soir, après avoir aidé sa mère, elle se cache pour lire des livres que son frère a laissés traîner. Mais dans sa communauté, l’idée qu’une femme puisse poursuivre des études ou travailler reste difficile à accepter.
Un jour, un atelier organisé par une association locale sur les droits des femmes et l’entrepreneuriat attire l’attention d’Amina. Malgré les réticences de sa famille, elle décide d’y participer. Là, elle rencontre d’autres jeunes femmes comme elle, prêtes à défier les normes sociales. Inspirée par ces échanges, Amina décide de s’inscrire à un programme d’alphabétisation proposé par l’association.
La route est semée d’embûches. Son père s’oppose violemment à ses projets, mais sa mère, voyant sa détermination, commence à la soutenir discrètement. À force de persévérance, Amina apprend à lire, puis à écrire. Avec d’autres femmes du quartier, elle crée un petit groupe de couture pour générer un revenu. Petit à petit, elle gagne la confiance des commerçants locaux et commence à vendre leurs créations.
Aujourd’hui, Amina est devenue un exemple pour son quartier. Elle a convaincu plusieurs femmes de rejoindre leur collectif et aide maintenant d’autres jeunes filles à apprendre à lire et à développer leurs compétences. Les mentalités changent lentement, mais Amina prouve que l’égalité est possible, même dans les contextes les plus difficiles.
Son histoire montre que l’émancipation des femmes ne profite pas qu’à elles-mêmes : elle renforce leurs familles, leurs communautés et toute la société. Offrir aux femmes des opportunités équitables, c’est ouvrir la voie à un avenir plus juste et plus prospère pour tous.
Rappel: attribue entre 0 et 5 points pour chaque question, calcule la somme et note sur une feuille tes points pour Amina
L’eau, une promesse pour Fatou et ses voisins

Histoire de Fatou
Dans une région aride d’Afrique de l’Ouest, Fatou, 36 ans, se lève chaque matin bien avant l’aube pour aller chercher de l’eau. Les femmes de son village parcourent des kilomètres à pied jusqu’à un puits où elles patientent parfois des heures. Cette eau trouble, souvent contaminée, est la seule ressource disponible pour boire, cuisiner et se laver. Les maladies d’origine hydrique sont courantes, touchant particulièrement les enfants, et Fatou ne peut s’empêcher de s’inquiéter pour ses deux petits.
Un jour, une organisation communautaire arrive dans le village avec un projet audacieux : construire un système d’accès à l’eau potable et des latrines. Mais les défis sont immenses : le terrain est difficile, les fonds limités, et certains villageois doutent de la faisabilité du projet. Pourtant, Fatou refuse d’abandonner. Elle s’implique dans chaque étape, motivant les autres femmes à participer au chantier. Ensemble, elles transportent des matériaux, creusent et apprennent à installer des filtres pour purifier l’eau.
Après des mois de travail acharné, le système est enfin opérationnel. Pour la première fois, le village dispose d’un point d’eau potable centralisé et d’un assainissement de base. Fatou voit immédiatement la différence : ses enfants tombent moins souvent malades, et elle n’a plus à marcher des heures sous le soleil brûlant. Plus encore, elle ressent une fierté nouvelle, celle d’avoir contribué à transformer sa communauté.
Aujourd’hui, Fatou est devenue une porte-parole dans sa région. Elle organise des ateliers pour d’autres villages, partageant son expérience et sensibilisant à l’importance de l’eau potable et de l’hygiène. Grâce à son énergie et à sa détermination, elle montre qu’un simple accès à l’eau peut changer des vies.
Cette histoire illustre que chaque goutte compte. Offrir un accès universel à l’eau potable et à un assainissement adéquat, c’est non seulement garantir la dignité humaine, mais aussi ouvrir la voie à un avenir plus sain et plus juste.
Rappel: attribue entre 0 et 5 points pour chaque question, calcule la somme et note sur une feuille tes points pour Fatou
La lumière de Mikhail
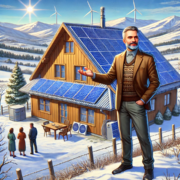
Histoire de Mikhail
Dans un petit village isolé des Carpates, en Europe de l’Est, Mikhail, 43 ans, vit avec sa famille dans une maison en bois qui a résisté aux hivers les plus rudes. Mais chaque année, le chauffage et l’électricité pèsent lourdement sur leur budget. Comme beaucoup d’autres habitants de la région, Mikhail dépend du bois de chauffage et d’un vieux générateur à diesel qui pollue l’air et gronde jour et nuit. Il rêve d’une alternative plus propre et plus économique, mais où la trouver ?
Un jour, une petite start-up locale, soutenue par des subventions européennes, propose une solution révolutionnaire : installer des panneaux solaires adaptés aux conditions hivernales rigoureuses. Au début, Mikhail reste sceptique. Comment ces panneaux pourraient-ils fonctionner dans une région où le soleil semble fuir une bonne partie de l’année ? Pourtant, l’idée de ne plus dépendre du générateur bruyant finit par le convaincre.
Avec l’aide d’une équipe de techniciens, Mikhail et ses voisins installent les panneaux solaires sur leurs toits. Le projet inclut également une batterie pour stocker l’énergie, ainsi qu’une petite formation sur leur entretien. L’hiver suivant, pour la première fois, Mikhail n’entend plus le bruit du générateur. Sa maison est chauffée, éclairée, et son portefeuille, pour une fois, n’a pas été vidé par les factures de carburant.
Le succès du projet ne passe pas inaperçu. D’autres villages des alentours contactent la start-up pour bénéficier du même programme. Mikhail devient l’un des ambassadeurs de cette transition énergétique. Lors des réunions locales, il explique avec fierté comment l’énergie propre a transformé sa vie et celle de sa famille, tout en réduisant la pollution dans sa vallée.
L’histoire de Mikhail montre que l’énergie propre n’est pas un luxe réservé aux grandes villes. Elle peut aussi transformer les communautés rurales et offrir une vie meilleure, tout en préservant l’environnement.
Rappel: attribue entre 0 et 5 points pour chaque question, calcule la somme et note sur une feuille tes points pour Mikhail
Le pari de Lisa et sa boutique mobile

Histoire de Lisa
Lisa, 29 ans, vivait dans une petite ville de la Rust Belt, une région du nord des États-Unis marquée par le déclin industriel. Les usines avaient fermé leurs portes les unes après les autres, laissant des quartiers entiers à l’abandon. Après des années de petits boulots précaires, Lisa rêvait de monter son propre commerce. Mais avec peu d’économies et des rues désertées par les clients, elle hésitait à se lancer.
Un jour, en parcourant un forum en ligne, Lisa découvre un programme d’entrepreneuriat soutenu par la ville pour revitaliser l’économie locale. Le concept ? Fournir aux habitants des véhicules aménagés pour démarrer une boutique mobile. Lisa saisit sa chance et présente son idée : un food truck dédié à une cuisine locale revisitée, utilisant des produits de petits agriculteurs de la région.
Le programme accepte son projet et lui accorde un petit prêt. Avec son camion flambant neuf, Lisa se lance. Les débuts sont difficiles. Elle se gare sur des parkings presque vides, essayant d’attirer les passants. Mais sa persévérance paie. Elle s’intègre à un réseau d’autres micro-entrepreneurs locaux qui s’entraident pour organiser des événements et créer une dynamique économique dans la région.
En un an, Lisa a non seulement remboursé son prêt, mais elle a aussi embauché deux anciens collègues en difficulté. Ensemble, ils développent de nouvelles recettes et élargissent leur offre. Les habitants commencent à affluer, non seulement pour savourer ses plats, mais aussi pour retrouver un sentiment de communauté. Lisa est fière de contribuer à faire revivre sa ville.
Aujourd’hui, son camion est un symbole d’espoir. Lisa sait que son succès n’est qu’une pièce du puzzle, mais elle voit l’impact : plus de clients, plus d’emplois, et une ville qui reprend peu à peu vie. Pour Lisa, travail décent et croissance économique ne sont pas de simples slogans ; ce sont les piliers d’un renouveau collectif.
Rappel: attribue entre 0 et 5 points pour chaque question, calcule la somme et note sur une feuille tes points pour Lisa
Le parcours de Mateo et Leïla

Histoire de Mateo et Leïla
Mateo, 25 ans, a grandi dans un quartier populaire de Barcelone. Diplômé en ingénierie, il enchaîne pourtant les refus lorsqu’il postule pour des emplois. « Pas assez d’expérience », lui dit-on souvent, mais Mateo se demande si ce n’est pas aussi parce qu’il a un accent marqué et un nom qui trahit ses origines modestes. De l’autre côté des Pyrénées, en France, Leïla, 28 ans, vit une situation similaire. Malgré son diplôme en marketing, ses candidatures restent lettres mortes. Elle se sent enfermée dans des préjugés liés à son origine maghrébine.
Un jour, Mateo découvre un programme européen appelé « Talent pour tous », destiné à promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi. Intrigué, il décide de s’inscrire. Le programme propose des ateliers de coaching, des rencontres avec des recruteurs, et surtout, une mise en relation directe avec des entreprises prêtes à miser sur la diversité. Leïla, en France, s’inscrit, elle aussi après avoir entendu parler du projet dans son réseau.
Lors des sessions, Mateo apprend à mettre en avant ses compétences plutôt que de se concentrer sur ses échecs. Il crée un CV vidéo, tandis que Leïla participe à un bootcamp où elle découvre des techniques de réseautage. Pour la première fois, ils se sentent valorisés pour ce qu’ils peuvent apporter, et non jugés pour ce qu’ils ne contrôlent pas.
Quelques mois plus tard, Mateo décroche un poste d’ingénieur dans une start-up locale. Il est surpris de voir à quel point ses idées sont écoutées. Leïla, de son côté, rejoint une agence de communication qui cherche justement des perspectives nouvelles pour s’adresser à des publics diversifiés. Tous deux réalisent qu’ils n’ont pas seulement trouvé un emploi ; ils ont ouvert une porte pour d’autres. Mateo partage son expérience dans son quartier, aidant d’autres jeunes à rejoindre le programme, tandis que Leïla monte une initiative pour sensibiliser les entreprises aux biais inconscients dans leurs recrutements.
L’histoire de Mateo et Leïla montre que réduire les inégalités, ce n’est pas seulement offrir des chances ; c’est créer un cercle vertueux où chacun, en trouvant sa place, aide les autres à trouver la leur.
Rappel: attribue entre 0 et 5 points pour chaque question, calcule la somme et note sur une feuille tes points pour Mateo et Leila
Le quartier de Rosa renaît

Histoire de Rosa
Rosa, 40 ans, vit depuis toujours dans un vieux quartier de Mexico, construit à l’époque pour accueillir les ouvriers des usines voisines. Aujourd’hui, le quartier est délabré : les immeubles s’effritent, les espaces publics sont abandonnés, et l’air est saturé par la circulation. Rosa se souvient de son enfance, quand les rues étaient animées par des marchés et des fêtes. Désormais, elle voit ses voisins partir un à un, espérant trouver mieux ailleurs.
Un jour, une annonce du gouvernement local retient l’attention de Rosa. Un projet de rénovation urbaine est lancé pour transformer les quartiers les plus défavorisés en espaces modernes et durables. Mais Rosa craint que ce projet ne profite qu’aux promoteurs immobiliers et chasse les habitants historiques, comme cela s’est déjà vu ailleurs. Pourtant, elle décide de se rendre à une réunion publique, par curiosité.
À sa surprise, les urbanistes, architectes et décideurs municipaux sont venus avec une autre approche : un processus participatif où les habitants auront leur mot à dire. Rosa prend timidement la parole pour exprimer ses craintes, mais aussi ses idées : des espaces verts pour les enfants, des zones piétonnes pour réduire la pollution, et surtout, des logements abordables pour éviter l’exclusion.
Au fil des mois, Rosa s’investit dans les réunions, où ses idées et celles de ses voisins sont débattues et intégrées. Les travaux commencent. Les vieux bâtiments sont rénovés plutôt que détruits, des arbres sont plantés le long des rues, et des panneaux solaires apparaissent sur les toits. Un jardin communautaire est créé, où Rosa et d’autres habitants cultivent légumes et herbes aromatiques.
Lorsque le projet est terminé, le quartier a retrouvé son âme. Les enfants jouent dans des parcs sécurisés, les marchés locaux revivent, et Rosa sent que ses voisins sont fiers de leur environnement. Elle est invitée à partager cette expérience dans d’autres quartiers de la ville, inspirant d’autres communautés à exiger des projets durables et inclusifs.
L’histoire de Rosa montre qu’une ville durable n’est pas seulement une question de techniques ou de politiques ; c’est un dialogue entre les habitants et les décideurs. Avec des projets participatifs, chacun peut contribuer à construire des espaces où il fait bon vivre.
Rappel: attribue entre 0 et 5 points pour chaque question, calcule la somme et note sur une feuille tes points pour Rosa
Les éco-créateurs de Lausanne

Histoire des éco-créateurs
À Lausanne, un groupe de six amis âgés de 18 à 25 ans partage une même obsession : réduire leur impact environnemental. Tout a commencé dans un café, où Lara, étudiante en biologie, a lancé une idée un peu folle : « Et si on créait une boutique zéro déchet ? Pas juste pour vendre des produits, mais pour inspirer toute la ville à consommer autrement. » Les autres, captivés, se joignent rapidement à son projet.
Ils décident d’appeler leur collectif Les Éco-créateurs. Leurs moyens sont limités, mais leur enthousiasme débordant. Chaque membre met à profit ses compétences : Kevin, étudiant en graphisme, dessine un logo accrocheur, tandis que Clara, passionnée de communication, lance des campagnes sur les réseaux sociaux. Jonas, lui, parcourt les marchés pour nouer des partenariats avec des producteurs locaux.
Leur première initiative est simple : organiser des ateliers dans les quartiers pour apprendre aux habitants à fabriquer des produits ménagers écologiques et réutilisables, comme des éponges en tissu ou des emballages à la cire d’abeille. Les ateliers rencontrent un succès inattendu : parents, étudiants et même des retraités viennent échanger, curieux de découvrir ces alternatives.
Encouragés, les Éco-créateurs passent à l’étape suivante : monter une petite boutique itinérante. Avec un vieux van transformé en magasin mobile, ils sillonnent Lausanne et ses environs, vendant des produits en vrac et recyclés, mais aussi des kits pour réparer et réutiliser des objets du quotidien. Leur van devient un lieu de rencontres et de discussions. Ils constatent que l’impact va au-delà des ventes : les gens se mettent à repenser leurs habitudes, à discuter de solutions entre eux.
Aujourd’hui, le collectif est une véritable référence locale. Ils collaborent avec des écoles pour sensibiliser les plus jeunes et travaillent avec des artisans pour valoriser les matériaux recyclés. Pour eux, la consommation responsable n’est pas une contrainte, mais une aventure collective où chacun peut jouer un rôle. Leur rêve ? Inspirer d’autres jeunes à lancer des initiatives similaires ailleurs.
L’histoire des Éco-créateurs de Lausanne montre que la transition vers une consommation durable peut être portée par des idées fraîches, de l’énergie, et un esprit de communauté. Avec des petits gestes répétés par beaucoup, un grand changement devient possible.
Rappel: attribue entre 0 et 5 points pour chaque question, calcule la somme et note sur une feuille tes points pour les éco-créateurs
Tane, gardien des mangroves

Histoire de Tane
Sur une petite île des Samoa, Tane, 17 ans, contemple la mer qui grignote chaque année un peu plus de terre. Les villageois parlent de tempêtes plus fréquentes, de marées plus hautes, et de la salinité qui tue les récoltes. Ces changements, Tane les connaît depuis qu’il est enfant, mais aujourd’hui, il comprend qu’il doit agir. Un jour, lors d’une réunion communautaire, il entend un ancien raconter comment, autrefois, les mangroves protégeaient l’île des tempêtes. Inspiré, Tane propose une idée audacieuse : restaurer les mangroves disparues.
Au début, les habitants sont sceptiques. Planter des arbres semble une goutte d’eau face à l’immensité du problème. Mais Tane insiste. Avec l’aide de son professeur de biologie, il organise un atelier pour expliquer le rôle des mangroves : ralentir l’érosion, absorber le carbone, et servir de refuge pour les poissons. Peu à peu, il rallie des volontaires, d’abord quelques amis, puis des familles entières.
Les jeunes de l’île se mobilisent. Ils collectent des graines de mangrove, apprennent à les planter, et surveillent les zones de reforestation. Chaque weekend, ils travaillent ensemble, transformant les plages dénudées en forêts naissantes. Leurs efforts attirent bientôt l’attention d’une ONG environnementale, qui fournit des ressources pour élargir le projet et éduquer d’autres villages.
Les premiers résultats ne se font pas attendre. Les tempêtes semblent moins destructrices, et les poissons reviennent dans les eaux bordées de mangroves. Les habitants commencent à croire que de petites actions peuvent avoir un grand impact. Tane, lui, ne compte pas s’arrêter là. Il propose maintenant des ateliers sur l’agriculture adaptée au changement climatique et rêve de voir son île devenir un modèle de résilience.
L’histoire de Tane montre que lutter contre les changements climatiques, ce n’est pas seulement agir à grande échelle ; c’est aussi encourager les communautés locales à protéger et à restaurer leur environnement. Chaque arbre planté est une promesse pour l’avenir.
Rappel: attribue entre 0 et 5 points pour chaque question, calcule la somme et note sur une feuille tes points pour Tane
Le filet de Minh contre les plastiques

Histoire de Minh
Minh, 30 ans, habite sur les rives du Mékong, l’un des plus longs fleuves d’Asie. Chaque jour, il regarde le fleuve emporter des tonnes de déchets plastiques, des bouteilles, des sacs, et même des emballages abandonnés. Il sait que ce plastique finira dans l’océan, menaçant les poissons et les récifs coralliens qui font vivre sa communauté. Minh se demande souvent : « Comment pouvons-nous protéger les océans si nous ne prenons pas soin de nos rivières ? »
Un matin, en parcourant les actualités, il tombe sur un article décrivant une solution utilisée dans d’autres pays : un système de filets flottants qui capture les déchets avant qu’ils n’atteignent les océans. Inspiré, Minh décide d’essayer. Avec l’aide de son frère, qui est soudeur, il conçoit un prototype simple : un filet suspendu à deux bouées, capable de flotter sur le courant et de piéger les déchets.
Le premier test est un succès. En une journée, le filet récupère des kilos de plastique. Mais Minh sait que ce n’est qu’un début. Il contacte un groupe d’activistes locaux et des autorités municipales pour élargir l’initiative. Ensemble, ils installent plusieurs filets dans des points stratégiques du fleuve. Ils organisent aussi des campagnes pour sensibiliser les habitants à l’importance de réduire leur consommation de plastique et de mieux gérer les déchets.
En quelques mois, l’impact est visible. Les filets interceptent des tonnes de plastique chaque semaine, et les écoles locales s’impliquent en organisant des collectes pour recycler les déchets récupérés. Minh et son équipe travaillent même avec des pêcheurs pour développer des dispositifs similaires pour leurs filets, limitant les prises accidentelles de plastique.
Aujourd’hui, Minh est fier de voir le Mékong plus propre et d’entendre parler de villages en aval qui adoptent cette solution. Pour lui, protéger les océans commence ici, sur les rives de son fleuve, là où les actions locales peuvent entraîner des répercussions globales.
L’histoire de Minh montre que la protection des océans ne se joue pas seulement au large : elle commence sur la terre ferme, avec chaque goutte d’eau qui rejoint la mer. Chaque geste, aussi petit soit-il, peut ralentir le flot de déchets vers les océans.
Rappel: attribue entre 0 et 5 points pour chaque question, calcule la somme et note sur une feuille tes points pour Minh
Kofi, les racines d’un avenir durable

Histoire de Kofi
Kofi, 38 ans, a grandi dans un petit village du Togo, entouré par les vastes champs de manioc qui nourrissaient sa famille. Mais en quête d’opportunités, il a quitté son pays pour étudier en Suisse à l’EPFL. Devenu ingénieur, il a toujours gardé une pensée pour son village natal. Lors d’une visite récente, il a été frappé par les changements : les terres autrefois fertiles étaient appauvries par des cultures intensives, et les forêts qui protégeaient la région avaient presque disparu.
Déterminé à agir, Kofi décide de lancer un projet ambitieux : combiner la production de manioc avec des pratiques d’agroforesterie, un système où arbres et cultures coexistent pour enrichir le sol, préserver l’eau et renforcer la biodiversité. Il commence modestement en collaborant avec deux familles d’agriculteurs. Ensemble, ils plantent des arbres fruitiers entre les rangées de manioc et installent des haies pour lutter contre l’érosion. Mais Kofi ne veut pas s’arrêter là : il rêve de créer une coopérative pour former d’autres agriculteurs et partager les bénéfices.
Le début est difficile. Beaucoup de cultivateurs, méfiants, hésitent à rejoindre l’initiative. Pour les convaincre, Kofi organise des ateliers, montrant comment l’agroforesterie peut augmenter les rendements sur le long terme tout en réduisant les coûts d’engrais chimiques. Petit à petit, les résultats parlent d’eux-mêmes : les champs retrouvent leur vigueur, les arbres commencent à produire des fruits, et les sols, enrichis par les racines profondes, retiennent mieux l’eau.
La coopérative voit le jour. Elle regroupe bientôt une trentaine d’agriculteurs qui partagent des ressources et investissent dans des équipements communs pour transformer le manioc en produits à haute valeur ajoutée, comme la farine ou l’amidon, qu’ils exportent sur les marchés internationaux. Kofi, lui, continue d’utiliser ses compétences d’ingénieur pour améliorer les pratiques agricoles et limiter les impacts environnementaux.
Aujourd’hui, les champs de manioc du village sont devenus un exemple pour la région : un modèle où la nature et l’agriculture travaillent en harmonie. Kofi revient souvent au Togo, convaincu qu’il ne suffit pas de produire plus : il faut produire mieux, pour protéger les terres pour les générations futures.
L’histoire de Kofi montre que des pratiques innovantes et respectueuses de l’environnement peuvent transformer des défis locaux en opportunités globales. La préservation des écosystèmes terrestres est un enjeu qui commence dans chaque champ et chaque forêt.
Rappel: attribue entre 0 et 5 points pour chaque question, calcule la somme et note sur une feuille tes points pour Kofi
Aisha, la bâtisseuse de ponts

Histoire d’Aisha
Aisha, 32 ans, est née dans une petite ville du Mali, marquée par des conflits communautaires entre agriculteurs et éleveurs. Ces tensions, nourries par la concurrence pour les ressources et exacerbées par des incompréhensions culturelles, ont souvent dégénéré en violences. Enfant, Aisha se souvient de nuits passées à craindre pour sa famille. Mais elle se souvient aussi de son père, un homme respecté dans la communauté, qui répétait toujours : « Un problème ne se résout pas avec des murs, mais avec des ponts. »
Inspirée par cet enseignement, Aisha décide, une fois adulte, de consacrer sa vie à promouvoir la paix. Elle rejoint une organisation locale qui travaille à établir des dialogues entre les différentes communautés. Un jour, on lui confie une mission délicate : organiser une rencontre entre des chefs communautaires, pour résoudre un différend sur l’accès à une rivière essentielle à la fois pour les cultures et le bétail.
Aisha commence par écouter. Pendant des semaines, elle voyage de village en village, rencontrant les parties concernées pour comprendre leurs besoins, leurs craintes et leurs attentes. Puis, avec l’aide de l’organisation, elle organise un grand « cercle de parole », où les représentants des deux camps sont invités à s’exprimer. La tâche est ardue : les rancunes sont profondes, et les émotions parfois à fleur de peau.
Mais Aisha ne baisse pas les bras. Elle facilite les échanges avec patience, cherchant des points de convergence plutôt que des divergences. Peu à peu, un compromis émerge : une gestion partagée de la rivière, avec des calendriers pour alterner les usages, et un engagement à créer une réserve d’eau commune pour les périodes de sécheresse.
Lorsque l’accord est signé, Aisha sent un mélange de soulagement et de fierté. Mais pour elle, ce n’est qu’un début. Elle forme désormais des jeunes à devenir des « bâtisseurs de ponts » comme elle, convaincue que la paix durable commence avec les générations futures.
L’histoire d’Aisha montre que la paix n’est pas un état, mais un processus. Elle exige du dialogue, de l’écoute et de l’engagement. Chaque pont construit rapproche un peu plus les communautés d’un avenir commun.
Rappel: attribue entre 0 et 5 points pour chaque question, calcule la somme et note sur une feuille tes points pour Aisha
L’alliance de Mila et le mouvement des 100’000

Histoire de Mila
Mila, 23 ans, étudiante en sciences politiques à Nairobi, avait toujours rêvé de faire une différence. Mais face aux défis du changement climatique, des inégalités et des injustices, elle se sentait parfois impuissante. Un jour, après une conférence universitaire, elle rencontre Karim, un jeune ingénieur du Maroc, et Sofia, une activiste espagnole. Tous trois partagent un constat : les gouvernements peinent à s’accorder, les intérêts divergent, mais la jeunesse, elle, pourrait agir, à condition d’être unie.
Cette rencontre est le point de départ d’un projet audacieux : créer un réseau international de jeunes mobilisés autour des Objectifs de Développement Durable. Ils commencent modestement, avec des appels en ligne et un blog pour partager leurs idées. Mais très vite, leur énergie attire d’autres jeunes : des étudiants, des entrepreneurs sociaux, des artistes, tous convaincus que leur génération peut faire bouger les lignes.
Leur premier projet commun est simple : organiser des ateliers locaux pour sensibiliser les jeunes aux ODD, tout en collectant des propositions concrètes d’actions à mener. En quelques mois, ils mobilisent des centaines de volontaires dans 15 pays. À chaque atelier, Mila, Karim et Sofia découvrent des idées innovantes : des campagnes pour réduire les déchets plastiques, des coopératives agricoles durables, et même des projets numériques pour connecter des communautés isolées.
Mais l’impact de leur mouvement explose lorsqu’ils décident de lancer un événement virtuel mondial. En associant conférences, débats et concerts en ligne, ils réussissent à mobiliser plus de 100’000 participants. Leurs mots-clés envahissent les réseaux sociaux, attirant l’attention de personnalités influentes et d’ONG internationales. Mila et ses amis réalisent alors qu’ils ont dépassé le stade de l’initiative locale ; ils sont devenus une voix mondiale.
Aujourd’hui, le réseau qu’ils ont créé continue de grandir. Des groupes régionaux se sont formés, et des partenariats avec des organisations internationales permettent de financer des projets portés par des jeunes dans des dizaines de pays. Mila, Karim et Sofia se disent souvent que leur succès repose sur une idée simple : travailler ensemble, au-delà des frontières et des différences, pour construire un avenir commun.
Cette histoire est de la fiction, mais proche de la réalité, car elle est inspirée, entre autres par des mouvements comme YOUNGO et Children and Youth International, qui prouvent que la jeunesse peut être un puissant moteur de création de partenariat mondial pour le développement durable.
Rappel: attribue entre 0 et 5 points pour chaque question, calcule la somme et note sur une feuille tes points pour Mila